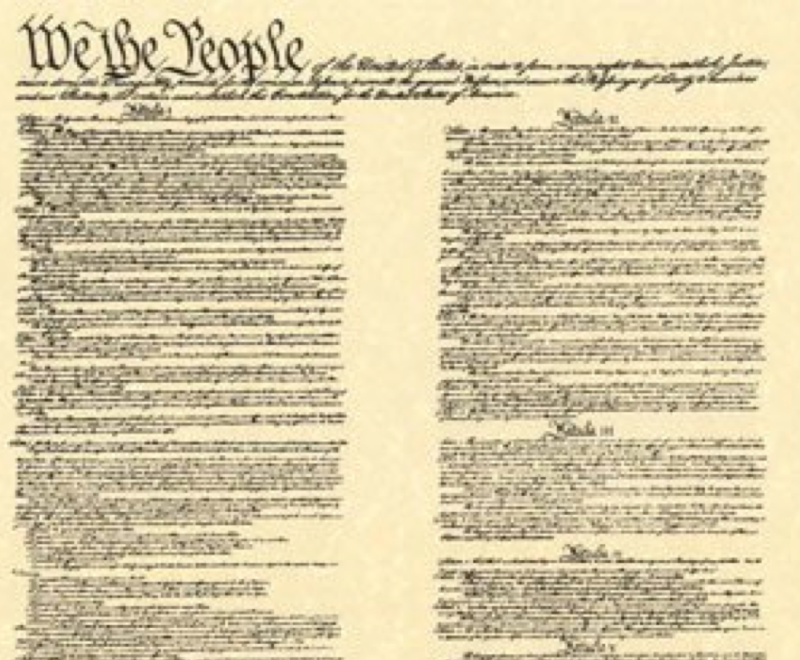Recensé : Yves Citton, Renverser l’insoutenable, Seuil, 2012, 212 p., 17€.
Dans quel présent vivons-nous ? La question ne cesse de nous hanter, sans trouver de réponse satisfaisante, puisqu’elle fait retour, toujours. Crise est le nom qui sert à qualifier couramment ce retour, sans que l’on sache bien de quoi l’on parle. D’abord parce que si notre présent est celui d’une crise, on peut se demander de quoi il y a crise : économique, morale, politique, axiologique voire anthropologique. Une crise ou des crises ? L’usage du singulier, la crise, semble faire rideau de fumée qui escamote la question. Mais tout le monde, ou presque, s’accorde sur le fait qu’il y a bien crise. L’évidence mérite d’être interrogée. Qu’est-ce qu’une crise qui dure depuis trente ou quarante ans ? Une manière d’être caractéristique d’un système, c’est-à-dire un régime. Crise est sans doute l’opérateur d’un régime politique et économique de domination qui constate le caractère insupportable du moment présent et s’efforce de le faire admettre en entretenant le sentiment illusoire de la sortie de crise, du rétablissement, plus ou moins proche, du patient en le perpétuant dans son état. « Il serait temps de s’apercevoir du leurre qui anime toute référence à « la crise », et qui en fait l’opérateur de pression le plus massif déployé dans nos sociétés actuelles. » (p. 93-94). Telle est l’une des fins que vise Yves Citton dans le livre qu’il publie aujourd’hui, fruit d’une réflexion qui est partie d’un travail collectif animé notamment au sein de la revue Multitudes.
Il va sans dire que dévoiler le leurre n’est pas nier la réalité des problèmes, sur un mode paranoïaque : « la crise » n’est pas une invention des gouvernants pour mieux opprimer les dominés. Le moment présent est bien celui où des obstacles s’accumulent de manière telle que « le genre humain périrait s’il ne changeait sa manière d’être » [1]. Le titre du livre est aussi une prise de parti : l’état présent est insoutenable. Le mot enveloppe deux traits féconds pour la pensée : d’une part dans son ambiguïté, il suggère que l’état de la situation est tissé de caractères objectivement déterminables et d’autres qui relèvent de la subjectivité ; d’autre part faisant constat, il ne s’indigne pas, comme le ferait par exemple intolérable. L’entreprise de Citton est rationnelle, renvoyant dos à dos thuriféraires et contempteurs du présent : « ni maudire, ni se moquer, mais comprendre ». Le principe spinoziste guide toute sa démarche : en même temps augmenter la puissance de penser du lecteur, c’est-à-dire son raisonnement, non ses passions, et sa puissance d’agir. S’il y a quelque chose d’insoutenable, si ça ne peut plus durer, l’urgence est de faire bouger les lignes pour rendre la situation vivable, un peu plus vivable. Mais comment y parvenir ? Sûrement pas en faisant « la révolution », si l’on suit l’auteur. Les deux tiers de l’ouvrage sont consacrées à la question de la politique, du faire individuel et collectif, qui tient aujourd’hui dans la mise en œuvre d’une part d’une politique des pressions, d’autre part d’une politique des gestes. Que faut-il entendre par là ?
Un présent cinq fois insoutenable
Disons-le d’emblée : Citton échappe à la posture du diagnostic d’époque. Son postulat méthodologique soutient qu’il faut s’appuyer sur la manière dont les agents vivent la situation, en éclairant ce qui rend injustifiables,insoutenables donc, les discours experts, qui ne cessent d’invoquer la nécessité économique comme cause des inégalités de plus en plus fortes, de plus en plus injustes, c’est-à-dire insoutenables en un deuxième sens.
Pourquoi ces discours sont-ils intenables ? Parce que la plupart des hommes éprouvent que ça ne peut plus durer longtemps comme ça, qu’il y a dans l’état présent quelque chose d’invivable à long terme, ce que l’anglais dit unsustainable. Qu’y a-t-il d’insoutenable ? La possibilité d’un développement durable, d’une croissance infinie parce que le mode de vie moderne crée les conditions de sa propre destruction, en raison des limites écologiques auxquelles il se heurte. Mais ce ne sont pas les seules : en se fondant sur la recherche du meilleur coût, le capitalisme dans sa version actuelle fait subir aux hommes une pression insupportable, insoutenable à raison de l’intensité de la pression qui s’exerce d’autant plus violemment qu’elle use des armes de la douceur psychologique : les méthodes du management en sont le paradigme, dont les suicides au travail sont l’expression la plus visible. Ce qui engendre des inégalités de plus en plus insoutenables, inacceptables, susceptibles de soulever l’indignation. Or, de cela nous sommes informés et désinformés par un flux d’images insaisissables, intenables qui nous traversent tous, orientant et modulant nos désirs, les fixant sur des objets bien souvent inaccessibles, mais toujours de l’ordre de la consommation marchande.
L’insoutenable se comprend donc en cinq sens : comme ce qui ne peut plus durer, ce qui ne peut être rationnellement validé, ce qui est injuste, ce qui est inacceptable et provoque l’indignation, et enfin ce qui est insaisissable physiquement.
L’analyse d’Yves Citton refuse d’identifier une source du mal qu’il suffirait de dévoiler et de tarir pour faire advenir une société juste. Au contraire, elle soutient que nous sommes déterminés de l’intérieur à être victimes et vecteurs de cet insoutenable : ainsi, c’est parce que nous désirons des objets de consommation hors d’atteinte que nous supportons les pressions managériales, d’autant plus déchirés que nous nous sommes mis en situation de supporter l’insupportable ; de là sans doute l’illusion d’un développement durable, voire d’une histoire orientée au progrès de l’humanité. La contradiction décrite est telle qu’il ne suffit pas de déloger la classe dominante pour que les problèmes soient résolus, alors même que la structure de domination, d’inégalité, d’exploitation est partie intégrante de l’état insoutenable de la situation. Ceux qui en bénéficient et qui sont déterminés à persévérer dans cet état en pâtissent aussi. Plus, à l’échelle mondiale, les bénéficiaires ne sont pas seulement les classes dirigeantes, mais aussi chacun de nous autres, lecteurs comme auteur de ces lignes tracées sur un ordinateur dont la production à bas coût en Chine est polluante pour la planète, ce dont nous parlons sur nos téléphones portables fabriqués dans les mêmes conditions.
Situation désespérée et porteuse de possibles réactions désastreuses ? Sans doute. Mais c’est indécidable : « Un seuil a peut-être été atteint, qui ne demande que l’injection de quelques germes politiques pour qu’une volonté collective opérationnelle puisse coaguler. » (p. 50)
Que faire ?
Question simple en apparence, réellement chargée de présupposés qu’il faut éclairer afin d’élaborer une réponse sérieuse, tant théorique que pratique (éthique et politique). Pour le dire d’un mot, Citton constate le décès de son sens léniniste : faire n’est pas agir en tant que sujet connaissant en vérité la situation objective et se donnant les fins à atteindre, solution aux contradictions qui rendent la situation révolutionnaire. En refusant clairement cette théorie de l’action politique, platonicienne aussi, il se situe dans la ligne de Spinoza critiquant les philosophes de l’État idéal. Du coup il esquive utilement une question bien souvent paralysante : si l’on admet qu’il y a crise, de quelle crise s’agit-il ? Crise finale du capitalisme ou crise dans le capitalisme ? Faut-il détruire le système ou l’aménager ? Révolution ou réforme ? Changement radical ou décroissance ? Populisme ou gestion raisonnable ? L’urgence est de sortir de ces antinomies tramées par la problématique de l’action en politique, afin de réagir et de comprendre les réactions nihilistes qu’elles suscitent. Décrire le présent en termes de pressions qui nous affectent et de flux qui nous traversent, engage une ontologie politique puis une théorie du faire qui raisonnent en termes de désir et d’affects, pour lesquelles la première question est celle de la limitation des pressions insupportables, question qui passe par celle de la désintrication des forces qui nous rendent impuissants en faisant de nous les vecteurs de l’insoutenable. Pour y parvenir il faut penser la politique non pas comme si nous étions des êtres totalement raisonnables calculant juste, mais partir des affects qui expriment les pressions que nous subissons et les pulsions par lesquelles nous y réagissons. Par exemple, au lieu de prendre un ton grand seigneur pour tancer le « populisme » en rappelant le peuple ignorant à ses devoirs, il faut s’efforcer de comprendre de quoi le vote d’extrême droite est le désir frustré, pourquoi aucun récit ne parvient aujourd’hui à découpler ce désir de la haine qui l’anime, afin de « régénérer un populisme émancipateur » (p. 83). Citton tente donc de concevoir une politique qui ne se fasse pas en termes d’amis/ennemis, mais de flux, de pressions et de contre-pressions.
Cela permet au moins d’ouvrir une voie pour sortir de l’impuissance présente, afin de constituer du commun, ou plutôt du comme un. La graphie est signifiante : l’unité produite ne devrait pas tomber dans l’illusion d’être unité réelle, substantielle comme le serait celle d’une nation ou d’une famille dont les membres imaginent qu’elle est naturelle. Cette politique des pressions n’est pas une politique du tout ou rien, mais elle se module en fonction des forces mises en œuvre et du commun sur lequel elles portent : les données naturelles, écologiques, à préserver, ou bien les institutions à transformer. En même temps elle se donne un principe de normativité : si le désastre contemporain tient à l’insoutenable de pressions subies et engendrant des inégalités, donc des injustices de plus en plus insupportables, alors les contre-pressions seront émancipatrices si et seulement si elles contribuent à l’égaliberté (selon la formule d’Étienne Balibar).
Comment mettre en œuvre une telle politique ? Comment influer sur les affects qui trament les rapports sociaux, les orienter vers des pratiques émancipatrices ? Non par un acte qui couperait l’histoire du monde en deux, mais par des gestes. À la politique de l’action menée sous l’horizon de la révolution, Citton substitue une politique des gestes opérant des renversements.
Les gestes politiques
Depuis le XVIIe siècle, « geste » désigne l’effet de manche d’un orateur incapable de modifier le réel. Au contraire, il faut retrouver le sens latin du terme, qui nomme ainsi ce qui a pu être soutenu au plan politique c’est-à-dire ce qui mérite d’être retenu. C’est le sens des res gestae d’Auguste par exemple, faits passés érigés en monuments de sa politique. Ce n’est pas ce dernier aspect que l’auteur retient. Il fait plutôt du geste une manière d’exposer une position dans le champ de la politique qui assume la responsabilité et le risque de l’intervention et déplace les termes qui le constituent. Dans la lignée d’Agamben, il y voit le mode d’intervention politique ajustée au monde de l’industrie culturelle et des moyens d’information contemporains, en même temps que ce concept lui permet de quitter une pensée de l’action fondée sur le sens, conçue comme réalisation intentionnelle d’un projet, au profit d’une théorie qui s’appuie sur les mouvements des corps en vue de mettre en œuvre une « conduite des conduites » (selon l’expression de Foucault). Le geste c’est d’abord le mouvement d’un corps qui, appréhendé sur la scène médiatique devient exemplaire, prenant sa consistance à raison de la contagion dont il aura été capable. Ainsi en est-il du geste de Bouazizi s’immolant parce qu’il est humilié par une femme policier lui interdisant la vente sur la voie publique. Geste de cette femme policier insupportable parce qu’humiliant celui qui ne trouve pas d’autre issue pour gagner sa vie, double bind étatique surdéterminé par le fait qu’il celui d’une femme, et qui rend la vie de cette homme imaginairement et réellement insupportable. C’est ce geste double qui résonne de manière telle qu’il finit par embraser la Tunisie, renverser la tyrannie en place et se répercuter dans tout le monde arabe. Non pas geste libérateur, annonciateur de bonne nouvelle, c’est-à-dire prophétique, mais mouvement de réaction, chargé d’ambiguïtés incarnant hic et nunc des affects collectifs. « Un geste entraîne plus qu’il ne fait comprendre ; il réveille, impulse, propulse — la langue anglaise dirait qu’un geste nous drives : il nous “conduit” (comme une voiture) par son énergie, sa force, sa direction, sa machinerie et son conatus propre. » (p. 156) Mais son conatus n’a d’efficace qu’en raison de la résonnance qu’il rencontre plus ou moins dans le champ dans lequel il a lieu, sans intention ni modèle possible.
Dans notre régime de médiocratie, régime de la médiocrité, et pouvoir des médias, puissance du conditionnement par le milieu, de la médiation, et pressions des moyennes (p. 174-184), seule un politique des gestes est efficace. On comprend pourquoi Berlusconi en est l’un des héros (et des hérauts) possibles. Ce n’est pas celui de notre auteur, cela va sans dire, mais la connaissance de ce que l’adversaire a compris est nécessaire à la conduite politique : le geste n’est pas émancipateur par essence. Quels gestes peuvent l’être ? Si, en régime médiocratique, la tendance à la médiocrité est structurelle, il est nécessaire à une politique d’émancipation de s’efforcer d’inverser ce flux en inventant des gestes qui fassent fond sur la vitalité du dissensus. Yves Citton se fait alors météorologue de la politique, non pour se livrer à des prévisions, mais pour dresser une carte ou une typologie des situations gestuelles en fonction des pressions, des intensités et de la temporalité, pour en énoncer la loi générale : « plus les pressions augmentent, plus les gestes deviennent ductiles, au point de pouvoir exceptionnellement renverser tout un régime de gouvernement perçu comme insoutenable. » (p. 188-189). Loi qui permet de décrire trois espèces de situation, de la « révolution » tunisienne, à la viscosité qui semble rendre inopérants des gestes « isolés » en passant par la labilité où l’on voit s’additionner, plus que se conjuguer, des gestes de refus (séquestration d’un P.D.G. par exemple).
Météorologie politique
Penser en termes de flux, de pressions, de variations d’intensité, de renversement de courant ou de tendance, invite à réfléchir la politique en usant de la dynamique des fluides, donc de la météorologie comme référent épistémologique. Il est susceptible de nous fournir un modèle pour penser le complexe de façon systémique et, surtout, pour intégrer à la connaissance des formations sociales et des opérations qui peuvent s’y déployer la dimension du hasard qui nous pare des risques que fait courir un déterminisme mécaniste, tel qu’on le trouve dans un marxisme sommaire ou dans la pensée dominante des économistes. S’il ne parle pas de l’aléatoire, Citton semble bien y avoir implicitement recours dans la description qu’il donne de « l’hypergeste » d’un Bouazizi renversant par contagion le régime de Ben Ali, en soutenant que sa puissance n’est explicable ni en termes de fait objectif, ni de processus.
Quelles sont les conditions qui rendent un geste efficace, c’est-à-dire capable de se propager ? Soutenir, avec Machiavel, que cela relève de la conjonction de fortune et de vertu, c’est tenir qu’il n’y va ni du sens de l’histoire, ni d’un projet rationnel. Ce n’est pas se mettre pour autant en situation d’attendre leur rencontre, les bras croisés puisque la vertu, la virtù, est force d’intervention rendue possible par la saisie du moment propice. Mais cela signifie qu’il n’y a pas de modélisation possible du moment opportun, pas de détermination de la situation objectivement révolutionnaire, mais un souci constant porté aux manières d’être et aux désirs en vue d’expérimenter tout ce qui peut contribuer à produire de l’égaliberté, hic et nunc, à l’expérimenter, parfois modestement, sans attendre. La fin du livre, qui dresse le bilan des types de situations selon les différents degrés de viscosité du milieu, porte sur cette question. J’aurais envie, si la place ne me manquait, de rapprocher ces analyses de celle que propose J.-T. Desanti dans Un destin philosophique [2] lorsqu’il évoque le Charlot des Temps modernes, rejeté de l’usine parce que son corps a résisté à devenir un rouage de la machine taylorienne, attrapant par hasard le drapeau rouge d’un chantier urbain, et se trouvant propulsé à la tête de la manifestation des chômeurs. Ce n’est pas seulement en raison des pressions, mais aussi des désirs et des croyances que cette conduite a-signifiante donne chair aux manques qui traversent le champ constitué par le groupe informe des chômeurs confluant vers un point de la ville. À travailler ce qui peut rapprocher et distinguer ces deux textes, on pourrait sans doute éclairer un peu mieux ce qui lie pressions dont les agents sont affectés, désirs qu’ils sont déterminés à avoir, croyances dans lesquelles ces désirs s’expriment. Ce qui permettrait de montrer l’ambivalence de la subjectivation. Si le désir s’investit spontanément dans un objet qui semble le satisfaire et sur une figure qui l’incarne, il devient en même temps captif de la croyance qui se constitue par là. Chez Desanti il s’agissait de rendre raison à la fois du caractère émancipateur du mouvement communiste et de sa sclérose dans cette subjectivation singulière qu’a été le parti communiste.
Cette manière d’intégrer la question implique de prendre en considération le rôle de l’adresse dans le discours : un commun (comme un) se forme aussi à raison de la parole qui lui est adressée, dans laquelle il se reconnaît plus ou moins. L’être comme un, « conduit comme par un seul esprit » dit Spinoza, c’est-à-dire l’unification de la multitude qui n’est pas fondée sur un réel substantiel (sur les condition socio-économiques par exemple) mais qui procède pour une part du fait de s’imaginer ensemble faire un, faire un peuple par exemple, a pour effet de faire apparaître un commun, un bien commun qui se donne comme ce qu’il faut faire advenir, comme cet intérêt universalisable qui motive d’agir en commun. Or c’est en parlant au nom de ceux qui sont là que se forment et se reproduit leur union, qu’ils s’opposent aux autres, adversaires ou ennemis. Qu’est-ce que parler au nom de ? Peut-on parler au nom de la multitude ? Au nom du peuple ? Est-ce affirmer un point de vue particulier contre un autre ? Ce serait le cas dans le nationalisme. N’est-ce pas tenter d’affirmer un commun réellement commun, raisonnable c’est-à-dire universalisable ? Quels en sont les modes contemporains ? Qu’est-ce qui les rapproche et les distingue de ceux qui ont été mis en œuvre au XXe siècle ? Autrement dit comment penser les contradictions contemporaines de la représentation ? Autant de questions à reprendre, sans doute.
Peut-être verrait-on alors ce qu’a de discutable la formule de « populisme émancipateur », en même temps que sa part de vérité. Ce qui demanderait de reprendre la question de la nature du un que l’on cherche à former en s’efforçant d’agir comme un. Populisme ne nomme-t-il pas, de façon inadéquate, cette croyance selon laquelle le peuple peut agir sans en passer par le jeu des institutions ? Comment articuler la « nécessaire intégration institutionnelle » (p. 126) et la lutte contre les non moins nécessaires oppressions bureaucratiques ? Comment favoriser « la culture active des minorités » (p. 129), seule capable d’ébranler les lourdeurs institutionnelles sans développer le sentiment de l’inanité de l’État, ou plutôt des institutions démocratiques, sachant que toute institution constitue un corps animé de son conatus particulier, donc capable de contrarier le bien commun ? On aperçoit que la question obsédante du « populisme » n’est pas secondaire.
Le livre d’Yves Citton se présente à nous non pas sous les espèces de la bonne nouvelle, puisqu’il prétend au contraire que toute annonce de ce genre est illusoire, donc asservissante. Il est bien plus que cela : une source de questions capables d’éclairer le présent, parce qu’elles sont à même de nous permettre de les approfondir, de prolonger la réflexion qui l’anime.