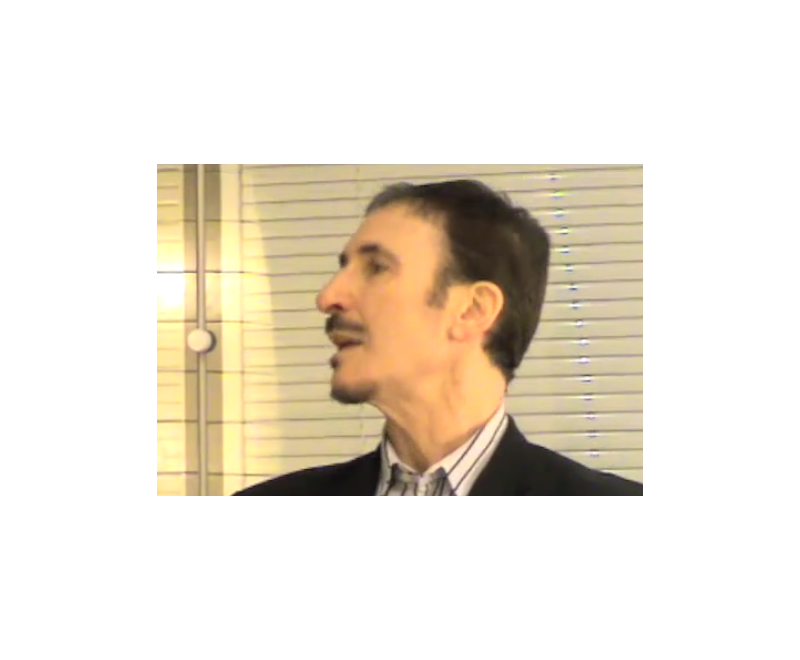Recensé : Ruth Fiori, L’invention du vieux Paris. Naissance d’une conscience patrimoniale dans la capitale, préface de Dominique Poulot, Wavre, Mardaga, 2012, 304 pp., 35 €
La modernité parisienne est une modernité nostalgique. L’élan du progrès ne s’est déployé dans la capitale que lesté du sentiment d’une perte, celle du « vieux Paris », auquel on s’attacha passionnément quand son existence apparut menacée par les démolitions. « Le vieux Paris n’est plus », écrivait Baudelaire (« Le Cygne », seconde édition des Fleurs du mal, 1861), et il semble que d’emblée il se soit donné comme perdu, si bien que l’on peut se demander s’il a jamais été : n’est-il pas plutôt le fruit d’une invention, certes littéraire mais aussi historique ? Telle est l’hypothèse explorée par Ruth Fiori dans L’invention du vieux Paris.
Pour commencer, il faudrait se demander de quand date ce « vieux Paris ». C’est-à-dire non seulement ce que désigne exactement cette expression : à quels édifices, à quel état de la ville, et à quelle époque l’adjectif « vieux », par définition mouvant à mesure que le temps passe, renvoie dans ce contexte. Mais aussi, du même coup, depuis quand l’idée même de « vieux Paris » existe, et comment, depuis lors, elle a organisé la conscience que l’on a de Paris.
Ruines de Paris
L’invention du vieux Paris s’attache d’abord, comme l’indique son titre, à restituer la genèse de la notion, la fluctuation des repères historiques qui l’encadrent, ainsi que les valeurs qui la sous-tendent et les actions qu’elle a permis, par conséquent, de légitimer.
Ruth Fiori montre en effet que l’expression, qui apparaît comme catégorie purement descriptive à la fin du XVIIe siècle (elle désigne alors le Paris d’avant la Renaissance), se généralise une première fois pendant les Lumières pour jouer un rôle de repoussoir : le vieux Paris est cet amas chaotique et boueux dénoncé par Voltaire, ce « centre de la ville obscur, resserré, hideux » (Embellissements de Paris, 1749, cité p. 54) légué par des siècles barbares. Sa description nourrit des rêves de table rase dont émergerait une ville neuve, à la fois propre, commode et surtout grandiose, digne d’être, comme elle le prétend, la capitale du monde civilisé. Aux arguments hygiénistes et fonctionnalistes s’ajoutent donc des considérations esthétiques – en l’occurrence imprégnées de la sobriété et de la régularité classiques –, nouage qui préfigure la manière dont s’articulera plus tard le discours haussmannien.
Avec l’émergence de la sensibilité romantique, et autour du foyer que constitue l’œuvre de Victor Hugo, une véritable inversion s’opère. Le vieux Paris est un « labyrinthe », certes, mais éblouissant, un « tricot inextricable de rues bizarrement brouillées » (Notre-Dame-de-Paris, cité p. 57), victime d’une modernité sans goût ni âme, aussi froide que calculatrice, qui enlaidit la ville à mesure qu’elle prétend l’embellir. Se construit et se fixe alors, à travers une littérature spécialisée et des albums de vue pittoresques comme ceux de Lancelot Turpin de Crissé (Souvenirs du vieux Paris, 1833) ou d’Alexandre Pernot (Le vieux Paris, 1838), l’image d’un vieux Paris, pré-révolutionnaire cette fois, qui servira de fil directeur aux luttes ultérieures contre le vandalisme d’État : les travaux d’Haussmann trouvent en face d’eux un discours et des convictions déjà bien enracinés.
Mais la radicalité des réalisations haussmanniennes provoque la transformation, décisive d’après Ruth Fiori, du souci romantique, originellement esthétique, en un souci proprement historique. La ville nouvelle qui se dessine, monotone et rigidement réglée, n’est pas seulement laide, elle est surtout, aux yeux de ses détracteurs, illisible et désespérément muette. L’ampleur des destructions qui engloutissent des quartiers entiers, menaçant de priver Paris de sa mémoire, appelle donc « la constitution d’une nouvelle histoire » (p. 72). D’abord pensée comme un remède à l’oubli, « une forme de compensation » (p. 77), cette nouvelle histoire va peu à peu doubler la ville réelle d’une présence spectrale, ressuscitée dans les livres, mais aussi dans Paris même, dont on commence à parer les murs de plaques et d’inscriptions, à marquer le sol du tracé d’édifices défunts. Le vieux Paris qui accède ainsi à la dignité d’objet d’érudition, n’est pas seulement un ensemble de bâtiments plus ou moins anciens. Il s’élargit progressivement à une atmosphère, un fourmillement de manières de vivre, de cris et de personnages de la rue, de métiers ou de fêtes disparus, dont les chroniques et descriptions, à la suite de Paris démoli (1853) d’Édouard Fournier ou de Ce que l’on voit dans les rues de Paris (1858) de Victor Fournel, se font de plus en plus nombreuses, et combinent de manière parfois subtilement intriquée l’exactitude historique des détails et la rêverie idéalisée.
La première moitié du XIXe siècle voit donc le vieux Paris devenir un « objet historique, digne d’être étudié », préalable nécessaire à sa conversion progressive en « objet patrimonial, digne d’être préservé et conservé » (p. 77) dans sa matérialité : le champ de ruines qui n’accueillait que lamentations est prêt à devenir un véritable champ de bataille.
De la déploration à l’action
Cette conversion est le fruit de l’action de différents « groupements » (terme générique retenu par l’auteur) de sauvegarde, objet central de l’enquête de Ruth Fiori, qui entend montrer, à partir de l’exemple de Paris, l’« importance des structures associatives dans la constitution du patrimoine » (p. 14). Le passage du travail théorique de l’érudition au militantisme, et à l’organisation de pressions sur la Ville et l’État, le passage de la dénonciation à la prévention, s’amorce dans les années 1870 pour aboutir en 1884 à la création par Charles Normand de la Société des Amis des monuments parisiens (SAMP), qui compte entre autres parmi ses membres Paul Marmottan, Charles Garnier, Albert Lenoir ou Eugène Müntz. La SAMP se veut, dès le départ, une « force permanente, gardienne jalouse et intelligente des diverses branches de l’art et de l’érudition » (Normand, cité p. 24). Secondée par un certain nombre d’autres associations, sociétés savantes d’arrondissements, et commissions locales telle la Commission municipale du Vieux Paris, elle fait preuve d’une inlassable obstination dans ses mobilisations pour la préservation du vieux Paris, à travers des publications, à la fois savantes et de vulgarisation, l’organisation de visites, de conférences, de banquets, l’interpellation directe des élus, ou encore la mise en œuvre d’amples campagnes de presse, qui savent à l’occasion faire preuve d’une certaine créativité (telle la publication, en 1870, d’un faire-part de décès des arènes de Lutèce). De ces mobilisations, Ruth Fiori retrace dans le détail un certain nombre d’exemples significatifs, autant d’affaires dont les rebondissements s’étalent parfois sur plus de vingt ans.
Les groupements n’obtiennent certes pas toujours gain de cause à l’issue de ces combats, et Ruth Fiori analyse alors précisément dans chaque cas les raisons de leurs échecs. Mais on trouve dans leurs réflexions et leurs actions, et c’est ce qui fait tout l’intérêt de l’enquête, le germe des idées de patrimoine et de monument dont nous dépendons aujourd’hui.
L’invention du regard patrimonial
La société des Amis des monuments parisiens est un exemple de contre-pouvoir théorique émanant de la société civile, qui va gagner peu à peu en audience et en autorité. Elle entreprend en effet, dès sa création, de développer une « contre-expertise » qui conteste pied à pied l’expertise officielle de la commission des Monuments historiques créée en 1837. La réputation de cette dernière est déjà entachée d’une « légende noire » (p. 113), assez largement fondée, ne serait-ce qu’en raison de son manque de pouvoir : elle assiste ainsi, impuissante ou complice, à de nombreuses destructions (l’hôtel de la Trémoille ou l’église des Célestins en 1841) et mutilations (la transformation en caserne de pompiers du collège des Bernardins en 1845), qui lui sont amèrement reprochées.
Mais au-delà de ces cas particuliers, l’opposition entre Amis des monuments parisiens et Monuments historiques est de nature théorique. Elle tient à la radicale divergence de leurs approches patrimoniales respectives, et à la différence de nature des regards sur la réalité urbaine qui leur sont attachés. Ruth Fiori montre ainsi que le propre des groupements de sauvegarde est d’avoir promu, à l’instar des conservateurs du musée Carnavalet, et dans le contexte propice de l’accès de l’histoire de l’art à la dignité d’une discipline à part entière, un regard proprement historique et documentaire, qui s’attache à ce qu’ils nomment la « valeur d’art et d’histoire » (p. 128), et se distingue dès lors du point de vue essentiellement esthétique ou artistique que les Monuments historiques ont hérité du romantisme.
Qu’est-ce qu’un monument ?
Cette différence de regard se manifeste avant tout dans la manière de circonscrire le champ patrimonial. L’analyse des listes de classement des Monuments historiques en cette fin de XIXe siècle montre qu’ils excluent, chronologiquement, tout (ou presque) ce qui est postérieur à 1750. Cela s’explique par des préférences esthétiques (l’institution est dominée par des hommes issus de la génération romantique, peu sensibles aux styles de l’Ancien Régime et de l’Empire), doublées de considérations idéologiques (ces styles étant souvent associés par leurs détracteurs aux régimes qui les ont promus). D’un point de vue typologique, les Monuments historiques privilégient une architecture officielle ou religieuse, savante, « monumentale » donc, au sens banal du terme. Ainsi, quand le percement de la rue Monge met à jour les arènes de Lutèce, dont la préservation aurait requis le rachat par l’État d’un terrain appartenant à la compagnie générale des Omnibus, les Monuments historiques livrent un avis défavorable, jugeant les arènes d’un « intérêt très médiocre au point de vue de la construction et des dispositions » (Viollet-le-Duc, cité p. 123), ce qui est incontestable si on les compare à celles de Nîmes ou d’Arles. Cependant, les groupements parisiens n’entendent justement pas défendre les arènes comme œuvre d’art, mais comme « souvenir historique et site archéologique » (p. 123). Cette notion de « souvenir historique » est de la même manière mobilisée pour légitimer la demande de protection de constructions non monumentales, d’architecture mineure ou vernaculaire, comme la mire du Nord, le moulin de la Charité dans le cimetière Montparnasse, ou les regards de Belleville, dont la valeur, rétrospective, tient simplement à ce qu’ils témoignent encore de quelque chose de disparu. C’est donc l’idée même de « monument » qui est redéfinie, explique Ruth Fiori qui doit ici beaucoup aux travaux de Françoise Choay, par le biais d’un retour à son sens étymologique : du latin monère, avertir, rappeler, le « monument » désigne à l’origine « ce qui interpelle la mémoire », bien au-delà des seuls édifices monumentaux, ou œuvres d’art à intention mémorielle.
En ce sens, un édifice n’a pas non plus besoin d’être beau, ou d’être jugé tel par un goût dont on commence à soupçonner la versatilité, pour être regardé comme « monument ». Comme le dit Georges Montorgueil, la Bourse par exemple (menacée en 1899 par un projet d’extension) « sans être en réalité une merveille, n’en est pas moins une page de l’histoire parisienne », puisque « ce palais symbolise la pensée de l’Empire imposant au vieux monde l’architecture des Césars » (cité p. 134). De même, on défend les pavillons de l’ancienne barrière du Trône (aujourd’hui place de la Nation) dont plusieurs élus d’arrondissement demandent la destruction, arguant de leur inutilité et de la désagréable lourdeur de leur architecture. Réponse de Lucien Lambeau, qui anticipe la réhabilitation de l’œuvre de Ledoux : « Qui peut répondre que cette architecture […] ne sera pas qualifiée plus tard d’architecture puissante et majestueuse ? » (cité p. 188)
Paradoxalement, cette approche historiciste du patrimoine comme témoignage amène peu à peu à étendre le « vieux Paris » au Paris moderne contre lequel il avait été élaboré. Ainsi, quand en 1886 un projet de métro aérien envisage de masquer Notre-Dame-de-Lorette et la Trinité, Charles Garnier rappelle que « ces églises nouvelles seront anciennes un jour » (cité p. 199). De même, la régularité de la rue de Rivoli, mise en péril par des surélévations disgracieuses, peut être jugée en 1906 « caractéristique de son temps, donc respectable » (Lucien Augé de Lassus, cité p. 232).
Enfin, le monument tel que le repensent les groupements ne se limite pas au seul édifice mais s’étend à ses abords, qui « ont une grande part dans son aspect » (bulletin de la SAMP, cité p. 200), puisqu’ils déterminent la manière dont il est vu, idée qui préfigure, comme y insiste Ruth Fiori, les notions bien plus tardives de « site » et de « paysage urbain ». La conjonction décrite par Eugène Hénard de la bibliothèque Sainte-Geneviève, du Panthéon, du lycée Henri-IV, et de l’église Saint-Étienne-du-Mont a au moins autant de valeur que chacun de ces édifices pris séparément. Tout comme l’esplanade des Invalides ne saurait être dissociée de l’hôtel dont elle est l’écrin. Inversement, le vide creusé autour de la tour Saint-Jacques, dernier vestige d’une abbaye invisible, en fait une sorte de readymade avant l’heure : « c’est une tour Eiffel dans le genre gothique » (Arthur Rhoné, « Réflexions sur l’enlaidissement progressif des villes qu’on embellit », 1889, cité p. 46). Du point de vue des Amis des monuments parisiens, les limites du patrimoine finissent donc par se confondre quasiment avec celles de la ville, à laquelle, au nom de l’histoire, il ne faudrait pas toucher.
Conserver ou restaurer
Car ce regard neuf transforme également la nature du respect que l’on pense devoir au patrimoine, c’est-à-dire ce que l’on entend par « sauvegarder » un monument. Sous l’influence dominante de Viollet-le-Duc, les Monuments historiques entreprennent de vastes chantiers de restauration qui confinent à la réédification, souvent largement imaginaire. La Ville privilégie de son côté les considérations pratiques, et donc des remises à neuf qui, lorsqu’elles permettent de réaffecter des lieux à de nouveaux usages, les sauvent de la disparition tout en les transformant amplement. Les érudits parisiens quant à eux, forts de leur conception du monument comme document, ou même comme relique, ne peuvent voir dans de telles entreprises que falsification, et finalement, saccage et destruction. Puisque la valeur du monument tient à leurs yeux à sa valeur de témoignage, elle requiert l’authenticité, et donc une politique de conservation qui se contente de consolider, aussi discrètement que possible, pour éviter l’effondrement. C’est là ce qu’ils réclament à Saint-Pierre-de-Montmartre, qu’ils ont contribué à sauver à grand peine malgré son délabrement et l’indifférence de l’archevêché. Mais la vieille église se voit affublée, lors de sa restauration sous l’égide de Sauvageot, d’un clocher anachronique qui la défigure et restera pour eux le symbole de l’incompétence des pouvoirs publics en la matière.
Cette conception « archéologique » du bâti et de la ville se heurte ainsi d’emblée à ses contradictions. Une église, pour rester une église, a besoin d’un clocher ; un bâtiment, une ville, sont faits pour être habités. Or, comme l’indique Ruth Fiori, la consécration de leur valeur historique prépare le « processus – certes beaucoup plus tardif – de muséification de l’espace urbain » (p. 254), et met en péril non seulement leur usage, mais, du même coup, leur raison d’être dans la ville. Plus encore, l’art de bâtir d’autrefois est également entendu et célébré comme un art de vivre : la valorisation du vieux Paris tient pour une large part à la nostalgie de son animation et de ses fêtes, en un mot, de sa vie. Ce que l’on voudrait préserver par-dessus tout est donc par définition ce qui s’y prête le moins, ce dont la conservation, signifiant inéluctablement embaumement, en ce qu’elle suppose la rupture de l’immédiateté de l’expérience et sa mise à distance par la conscience (en l’occurrence, historique), ne peut entraîner que la mort que l’on voulait éviter.
« La beauté de Paris » est-elle politique ?
L’histoire du vieux Paris est donc celle de la conquête progressive d’un regard qui se voudrait axiologiquement neutre, aussi bien esthétiquement que politiquement. La SAMP se présente dès sa naissance comme indépendante des partis, et il semble qu’effectivement les appartenances politiques de ses membres soient très variées. Le souci de la préservation du patrimoine ne serait donc pas l’apanage de conservateurs qui prôneraient un retour au passé, la coloration nostalgique de leur combat n’est pas directement réactionnaire, elle se veut même, dans le discours du moins, ouverte sur l’avenir. Et certes, comme le souligne Ruth Fiori, la gigantesque reconstitution du « Vieux-Paris » conçue par Albert Robida et proposée comme attraction aux visiteurs de l’Exposition universelle de 1900, côtoie la tour Eiffel, le métro, et la glorification de l’électricité. Mais cela suffit-il à établir, comme elle l’affirme, « sa non-contradiction avec l’idée de modernité » (p. 99) ? On peut ici regretter que l’auteur ne montre pas davantage comment et jusqu’à quel point, au-delà des seules déclarations d’intention, la foi dans le progrès et l’amour du passé ont pu se concilier.
Quoi qu’il en soit, au-delà de leurs divergences idéologiques, c’est le regard patrimonial qu’ils inventent qui permet aux amis du vieux Paris de se rassembler, comme le montre par exemple le cas de la chapelle expiatoire, dont ils tâchent de dévoiler, face aux élus républicains émus de voir un tel symbole politique persister, la valeur patrimoniale « invisible » (p. 186) : « La Chapelle expiatoire est le témoin d’un état d’esprit qui anima une renaissance littéraire toute pénétrée de l’admiration, souvent intempérante, du passé ; elle est aussi l’œuvre de méthodes d’art qui tiennent dans la série des architectures françaises une place impossible à supprimer » (Jacques de Boisjoslin, cité p. 186).
Ruth Fiori a cependant le mérite de nuancer ce constat, en suggérant par exemple que l’attachement ou la redécouverte des hôtels d’Ancien Régime n’est pas tout à fait dénuée d’arrière-pensées politiques. Surtout, elle montre comment, au début du XXe siècle, les débats houleux sur « l’américanisation » de Paris, se situent en réalité « à la frontière entre l’imaginaire urbain et le questionnement identitaire » (p. 290). La défense de « la beauté de Paris », qui apparaît alors comme condition du rayonnement de la « capitale des capitales » (Massart, cité p. 243), est devenue un enjeu politique national. Derrière la dénonciation récurrente des soi-disant « gratte-ciel » que des observateurs inquiets croient voir dans certaines constructions en hauteur, pourtant bien modestes au regard des tours américaines, se cache la défense d’un modèle, non seulement architectural, mais social et culturel, qui s’incarne dans une certaine vision, humaniste et artistique, de la ville. Dès lors, l’idée déjà séculaire d’un Paris scindé en deux villes, distinctes et ennemies, s’estompe : le vieux Paris et le Paris moderne sont réunifiés par la hantise d’une ville livrée aux mains de l’étroit matérialisme des ingénieurs, dont on attend tous les maux, à commencer par l’ennui et la laideur, auparavant attribués à la modernité.
Charles Garnier résume ce combat d’une formule rétrospectivement saisissante : « Paris ne doit pas se transformer en usine ; il doit rester un musée » (cité p. 240). C’est-à-dire un lieu où l’art est célébré, mais dans un suspens qui ne cesse de mettre en péril la vie qu’il a voulu magnifier. Paris, devenu tout entier le « vieux Paris », a gagné le prestige d’une auréole de souvenirs qui ne le rend admirable qu’en faisant signe vers ce qu’il n’est plus, et n’a peut-être jamais été. Déréalisé, « Paris » semble toujours ailleurs, et c’est peut-être pourquoi il est aujourd’hui si difficile de savoir comment y bâtir et comment y vivre.